| |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
Entracte
: |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |


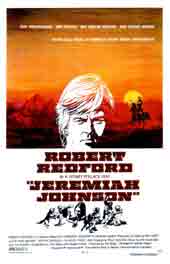


|
|
On
ne peut pas parler de cinéma sans évoquer les
compagnies pionnières qui furent à l’origine
de la création du cinéma et de sa diffusion. Aujourd’hui,
nous allons jeter un œil sur la Warner Bros.
Cette compagnie – à l’origine, la Warner
Brothers – fut fondée en 1923 par les frères
Harry, Sam, Albert et Jack L. Warner, quatre émigrants
polonais dont le père s’était établi
aux États-Unis en 1890. Les quatre frères commencèrent
en organisant la projection de courts-métrages souvent
accompagnée de numéros musicaux. Harry, le plus
réaliste, fonda le premier groupement d’exploitants
des États Unis : la Duquesne Amusement Supply Company.
Jack, qui écrivait des scénarios, trouva un réalisateur
en Sam qui se lança dans la réalisation de westerns
en deux bobines et créa en 1912, une société
de distribution à Los Angeles. Jack fit de même
à San Francisco, la machine était lancée.
Ils installèrent un service de production à Los
Angeles alors qu'Harry et Albert assuraient depuis New York
le financement et la distribution des films.
En 1917, les frères Warner louent un studio dans le Bronx
et tournent le premier long métrage américain
de propagande, une histoire inspirée des souvenirs de
l’ambassadeur James W. Gerard : « My four
years in Germany ». Nous sommes en 1918 ! C’est
un triomphe doublé de l’opportunité de construire
leur propre studio sur Sunset Boulevard. C’est alors le
début des films de gangsters et des drames sociaux. William
Nigh réalise, en 1921, « Parted Curtains ».
Pour alimenter la production de cinq longs métrages chaque
année, un banquier du nom de Motley Flint entrera dans
la danse et 1923 sera l’année de la fondation officielle.
La compagnie se dotera de nouveaux équipements pour tourner
dans des conditions plus confortables. La même année,
ils engagent Ernst Lubitsch qui tourne pour eux ses premières
comédies américaines : « Comédiennes »
en 1924, « L’éventail de Lady Windermere »
en 1925 et « Les surprises de la TSF »
en 1926. En avril 1925, ils prennent possession des studios
Vitagraph et en novembre de la même année, ils
engagent Michael Curtiz qui devient, grâce à eux,
le réalisateur le plus créatif du studio en 1927.
Ils prennent ensuite le contrôle d’une série
de courts métrages sonorisés grâce au procédé
Vitaphone. La même année sortira le premier long
métrage sonore de l’histoire du cinéma :
« Le chanteur de Jazz » de Alan Crosland.
Un succès garanti et le début de l’aventure
du parlant.
1927 est aussi l’année du décès de
Sam, à quarante ans, mais rien ne peut plus les arrêter.
Septembre 1927, ils prennent le contrôle de la First National.
Ce sera pour eux l’accès à des centaines
de salles et ils deviendront les Majors d’Hollywood. On
peut qualifier alors la Warner de société populaire
et réformiste. Elle ne se contente pas de décrire
la crise des années 30, elle veut l’humaniser par
l’humour et l’émotion, et aussi avec un brin
d’indignation qu’on peut trouver simpliste. Elle
parle des drames de la dépression dans « Wild
Boys of the road » de William A. Wellman, en 1933,
ou des abus du système carcéral dans « Je
suis un évadé » de Mervyn Leroy, en
1932. Parmi les critiques de l’époque, certains
n’hésiteront pas à dire que la Warner fonctionne
comme une usine, voir une galère ! C’est peut-être
vrai. Rendement, vitesse, économie sont ses trois impératifs
mais en sont-ils complètement responsables ? Le climat
de l’époque était détestable. La
montée du fascisme, les vertus de la démocratie,
avec celles de l’humanisme pour toile de fond, tout se
mélangeait un peu. Ces années difficiles virent
pourtant le regain du cinéma féministe avec des
actrices comme Bette Davis – à considérer
comme une rescapée de la bataille juridique avec la Warner
– qui triomphera en 1938 dans « L’insoumise »
(Jezebel) de William Wyler. Dans un registre plus populaire,
s’affirmeront des actrices comme Barbara Stanwyck dans
« Révolte à Dublin » en
1936, de John Ford, ou Ida Lupino en 1937, avec « Artistes
et modèles » de Raoul Walsh.
Mais si la guerre fait peser sur la famille des menaces immédiates,
les trois frères ne resteront pas neutres puisqu’ils
permettront à Anatole Litvak de réaliser le premier
film antinazi : « Confession d’un espion
nazi » qui sortira en 1939. Dans le même registre,
en 1942 Michael Curtiz réalisera « Casablanca »
puis « Passage to Marseille » en 1944.
A noter, deux chefs d’œuvre produits dans cette conjoncture,
des films policiers : « Le Faucon maltais »
de John Huston, en 1941, et « Le Grand sommeil »
de Howard Hawks, en 1946.
Le climat de l’après-guerre ne vaudra guère
mieux. Ce sera le début du maccarthysme et la croisade
anticommunistes – la hantise des Américains. Puis
viendront les lois anti-trusts obligeant les Majors d’Hollywood
à scinder leurs services de production et d’exploitation
et entraînant une époque de précarité
pendant laquelle, paradoxalement, naîtront de superbes
films. Pendant cette période, Walsh réalisera
« La Vallée de la peur » en 1947,
et « L’Enfer est à lui »
en 1949, Michael Curtiz « Boulevard des Passions »
en 1949 et « La femme aux chimères »
en 1950 et en 1949, King Vidor « Le rebelle ».
Ensuite la Warner des années 50 s’orientera vers
des films familiaux et musicaux, avec Doris Day, et des films
d’aventure comme : « La flèche
et le flambeau » de Jacques Tourneur en 1951. Le
temps des vétérans viendra avec John Ford et « La
prisonnière du désert » en 1956, Raoul
Walsh et « L’esclave libre » en
1957, Howard Hawks et « Rio Bravo » en
1959. Ce sera grâce à la Warner que l’on
parlera de Burt Lancaster, John Wayne et avec le célèbre
« Une étoile est née » de
Cukor, en 1954, de Judy Garland. Viendront ensuite des films
dont la marque, différente, annoncera un autre cinéma :
« À l’Est d’Eden »
d’Elia Kazan, en 1955, puis « Le Gaucher »
d’Arthur Penn, en 1958.
En 1967, Jack est le dernier à détenir des parts
de la Warner. Il les vend à la compagnie canadienne Seven
Arts. Et comme tout le monde dévore tout le monde, en
1969, la Warner passe sous le contrôle d’une société
de parking et de services funéraires, la Kinney National
Service ! En 1988, Warner fusionnera avec le groupe de communication
Time Inc.
Alors, ce soir, je vous quitte car il n’est plus question
de cinéma mais d’affairistes. Mais pour ne pas
rester sur ce triste constat, je mentionnerai l’esthétique
« Barry Lyndon » de Stanley Kubrick, de
1975. Si l’histoire est sordide, la magie des lumières
et des couleurs et la sublime bande sonore opèrent l’alchimie,
et également, mais dans le registre de l’hymne
à la nature, « Jeremiah Johnson »
de Sydney Pollack, de 1971. Deux chefs d’œuvres !
Il n’y a pas que les écus d’or dans la vie...
|
|





|
|
| |
 |
|
 |

|
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |

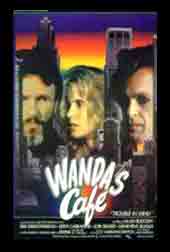


|
|
Je
vais faire une seconde incursion dans le film policier car certains
thèmes méritent un détour comme ce film
de 1942 « Les Yeux dans les Ténèbres »
de Fred Zinnemann avec Ann Harding, Edward Arnold, Donna Reed :
une femme a recours à un ami détective –
aveugle – pour dissuader sa belle fille de fréquenter
son ex-amant. Cadavre et chantage seront le lot du détective
aveugle et de son chien qui mettront en échec une bande
d’espions. La prouesse vient du fait que le réalisateur
a situé l’action au niveau de l’aveugle.
Ce film aura d’ailleurs une suite en 1945, « The
hidden eye » mais sera réalisé par
Richard Whorf.
De la même époque, un bon polar français
« Le Voyageur de la Toussaint » de Louis
Daquin, de 1943, d’après le roman de Georges Simenon,
avec Jean Desailly, Gabrielle Dorziat, Jules Berry, Simone Valère
et Louis Seigner. L’action se passe dans une ville de
province. Un jeune homme timide vient recueillir la succession
de son défunt oncle, empoisonné à l’arsenic.
Il doute de la culpabilité de sa tante immédiatement
soupçonnée et finit par démasquer les coupables.
Jean-Louis Trintignant, Danièle Delorme, Charles Gérard,
Yves Robert, Judith Magre composent l’affiche du film
de Claude Lelouch « Le Voyou » en 1970.
À noter également la présence de Charles
Denner, acteur au phrasé si particulier que l’on
retrouve souvent dans la distribution de ce metteur en scène.
C’est le thème de la trahison et de la vengeance
après l’évasion d’un gangster qui
se remémore l’organisation d’un kidnapping.
Entre espionnage et polar exotique, « Voyage au pays
de la peur » de 1942, de Norman Foster, nous emmène
en Turquie, avec un ingénieur de la navy qui fuit son
hôtel sans même avertir sa femme. Il pense semer
les espions qui le poursuivent mais il ne soupçonne pas
qu’ils n’ont pas perdu sa trace. D’après
le roman d’Eric Ambler, avec Joseph Cotten, Dolorès
del Rio et Orson Welles qui marque toujours un film de son charisme.
Il supervisa d’ailleurs la réalisation.
Maintenant, un excellent film de 1946 « The Verdict »
de Don Siegel, d’après le roman d’Israël
Zangvill, avec Peter Lorre et Joan Lorring. À Londres,
à la fin du siècle dernier, un inspecteur de police
qui se voit contraint de démissionner parce qu’il
a fait pendre un innocent tente de commettre le crime parfait.
Déjà l’ombre du chômage dans « Les
voleurs de la nuit » de Samuel Fuller, en 1983, d’après
un roman « Le chant des enfants morts »
d’Olivier Beer. Avec Véronique Jannot, Victor Lanoux,
Micheline Presle et Claude Chabrol en comédien. Une jeune
femme et son violoncelliste de mari, tous deux au chômage,
décident de s’en prendre aux employés de
l’ANPE qu’ils jugent responsables de leur misère
sociale.
Dans les films divertissants sans surprise « Vivre
et laisser mourir » de 1973, de Guy Amilton, d’après
le roman de Ian Fleming, avec Roger Moore et Jane Seymour, est
un bon 007. En 24 heures, trois agents des services secrets
britanniques sont tués. Bond, James Bond ! intervient
en plein culte vaudou. Roger Moore succède à Sean
Connery. Ce ne sera plus jamais la même chose !
« La ville des silences » de Jean Marboeuf,
de 1979, m’avait beaucoup plu. Avec Michel Galabru, Michel
Duchaussoy et Jean- Pierre Cassel, le détective, qui
devra lever la chape de plomb qui pèse sur la petite
ville. La vie de toute la population dépend de l’usine.
Il comprendra à ses dépens qu’il ne faut
pas enquêter sur la mort d’un patron.
Un thème qui revient dans les policiers : la disparition
d’époux successifs qui fabrique les veuves à
répétition. C’est le cas dans « La
veuve noire » de Bob Rafelson, de 1986, avec Debra
Winger, Theresa Russell et Samy Frey. Alexandra Barnes, qui
travaille pour la justice fédérale, est intriguée
par la similitude qu’elle constate entre des morts suspectes.
Elle découvre que les veuves n’en sont qu’une,
mais pour elle, le véritable danger viendra de la fascination
que la veuve exerce sur elle.
Le polar bien construit « La valse des truands »
de Paul Bogart, de 1969, d’après un roman de Raymond
Chandler, avec James Garner, Rita Moreno et Sharon Farell, met
une fois de plus en scène le fameux détective
Marlowe qui, cette fois, est chargé de retrouver un homme
qui a disparu. Les meurtres s’accumuleront jusqu’à
la résolution de l’énigme.
Dans le registre du policier musclé, « Urgence »
de 1985, de Gilles Behat, avec Richard Berry, Fanny Bastien,
Jean-François Balmer et Bernard-Pierre Donnadieu en parfait
salaud, met mal à l’aise. Une intrigue dans le
milieu nazi. Une jeune femme menacée se confie à
un journaliste qui va démêler l’affaire.
Toujours dans la lignée des films à thème
« L’union sacrée » d’Alexandre
Arcady, de 1989, avec Richard Berry, Patrick Bruel, Bruno Crémer,
Claude Brasseur, Saïd Amadis, Corinne Dacla, Marthe Villalonga
et Amidou met en scène la confrontation épique
entre deux policiers – l’un juif, l’autre
arabe – chargés de travailler ensemble. La
lutte contre le terrorisme et les fanatiques finira par les
rapprocher.
Je terminerai par deux films, bien que différents, qui
ont un relief certain : « Wanda’s cafe »
de 1985, d’Alan Rudolph, avec Kriss Kristofferson, Keith
Carradine, Lori Singer et Geneviève Bujold. Wanda’s
café est un lieu trouble qui réunit tous les losers
de la ville. Lorsqu’un truand sort de prison et a du mal
à retrouver un travail et un amour, la société
ne lui fait pas de cadeau. La mort sera au bout de la route.
Mais le plus beau policier de ce soir évolue dans un
climat pseudo-folklorique, c’est « Witness »
de 1984, de Peter Weir qui affectionne les ambiances chargées
de détails. Avec Harrison Ford, Kelly McGillis, Josef
Sommer et Lukas, le jeune garçon. Le film repose totalement
sur cet enfant, témoin d’un règlement de
comptes, et placé sous la protection d’un policier.
Les truands finiront par retrouver sa trace dans une communauté
amish, rurale et agraire, qui refuse le progrès technique
et l’évolution des mœurs. Les scènes,
bien décrites, sont sans parti pris. C’est un film
policier rare et esthétique et même si la vision
des Amish est utopique avec sa dose de duplicité et d’hypocrisie,
ce petit bijou reste un fait marquant dans l’histoire
du cinéma américain. Et malgré l’émotion
suscitée par la séparation, prévisible,
de nos deux protagonistes… je vous souhaite une bonne
nuit !
|
|



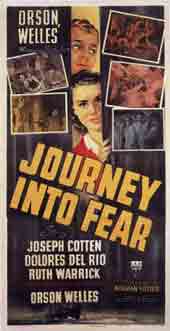
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Gregory
Peck 1916-2003 |
|
|
|
| |





|
|
Dès
qu’il apparaît sur les écrans, on ne peut
que penser : « Quelle classe ! »
Il est grand, beau, élégant, il a reçu
à la naissance le triptyque de la réussite pour
faire une carrière au cinéma.
Gregory Peck est né le 5 avril 1916 en Californie.
Ses parents divorcent lorsqu’il a six ans, il est élevé
par sa grand-mère et entre à dix ans à
l’Académie militaire de St-John à Los
Angeles. Alors qu’il entame des études de médecine,
il comprend que son véritable intérêt
va à l’écriture et à l’art
dramatique. Il termine néanmoins puis part à
New York et débute à Broadway en 1942. Dès
le début de sa carrière, il est remarqué
au théâtre mais très rapidement, Hollywood
le sollicite.
Dans le cinéma américain, il incarne la réflexion
intérieure et même si sa vie oscille parfois
vers le tragique – son fils Jonathan se suicide
à l’âge de trente ans –, il
n’en reste pas moins son sourire si particulier, sa
discrétion et son charisme. À la ville, c’était
un gentleman : lors du tournage de « Vacances
romaines », apprenant que le cachet d’Audrey
Hepburn est ridicule, il demande qu’il soit augmenté
et à la mort d’Eva Garner, il engage sa femme
de ménage et adopte son chien ! Ses apparitions à
Cannes sont toujours d’une grande sobriété.
Il est l’homme des engagements, œuvres de solidarité
et nombreuses autres causes, notamment contre la guerre du
Vietnam cependant, il a toujours démenti la rumeur
d’une éventuelle candidature à l’élection
de gouverneur de Californie.
Il a tous les talents. Il incarne des personnages inquiétants
pour Hitchcock, comiques pour Minnelli, même s’il
y est utilisé à contre-emploi, des aventuriers
tenus par la mauvaise conscience mais désireux de s’améliorer…
C’est un acteur authentique, scrupuleux et lucide qui
aime être, dans ses rôles, au plus près
de ses convictions comme dans « Du silence et des
ombres » où il incarne l’avocat d’un
homme noir.
En 1958, il tente la production avec « Les grands
espaces » et plus tard « Le plus beau
jour de notre vie » de Gordon Davidson, un film
courageux qui évoque les luttes contre la guerre du
Vietnam. En 1978, il rédigera son autobiographie « An
Actor’s life ». Sa filmographie est impressionnante
mais, pour moi, seuls quelques chefs d’œuvres résistent
au temps. Pour citer les principaux : « Jours
de gloire » de Jacques Tourneur en 1944, « La
maison du docteur Edwardes » d’Alfred Hitchcock
en 1945, puis l’un de ses plus grands « Duel
au soleil » de King Vidor en 1946, ensuite « Le
Procès Paradine » toujours d’Hitchcock
en 1947, un film d’aventure d’après E.Hemingway
« Les neiges du Kilimandjaro » en 1952,
et une bluette « Vacances romaines »
de William Wyler en 1953 qui vaudra un oscar à Audrey
Hepburn. Puis en 1958, un superbe western « Bravados »
d'Henry King, « La gloire et la peur »
de Lewis Milestone en 1959, et bien sûr « Les
canons de Navarone » de Jack Lee Thompson en 1961
et « Les nerfs à vif » du même
metteur en scène. N’oublions pas la grande fresque
qu'est « La Conquête de l’Ouest »
de John Ford et Henry Hathaway, « Et vint le jour
de la vengeance » de Fred Zinnemann en 1964, et
« Arabesque » de Stanley Donen en 1966.
Deux petites merveilles suivront « L’homme
sauvage » un film d’un expressionnisme déroutant,
de Mulligan en 1969, et « L’or de Mackenna »
de Jack Lee Thompson. Les cinéphiles n’auront
pas oublié « Le Pays de la Violence »
de John Frankenheimer de 1970, puis « Quand siffle
la dernière balle » d'Henry Hathaway de
1971, et « Un colt pour une corde »
de Ted Kotcheff de 1975.
Sa personnalité et ses personnages sous tension feront
de lui un pionnier des grands espaces américains et
donneront un sens épique à ses personnages de
western, sans doute les plus beaux. En 1987, viendra « La
Force du silence » de Mike Newell et grâce
à lui, « Old Gringo » de Luis
Puenzo en 1989 sera supportable ! On peut juste regretter
les superproductions dogmatiques de la fin de sa carrière
qui ne cadrent plus avec le summum habituel des années
40 à 60.
Avec son rythme ralenti, sa stature, ses sourires à
peine contenus, il incarne ce qui s’est fait de mieux
dans le septième art. Il n’aura pas toujours
été épargné par la critique et
pourtant, il savait impliquer le spectateur dans ses films ;
il a été le grand exécuteur de l’indifférence
! Il me fait penser à ces rimes d’une chanson
de Claude Nougaro :
« Sur l'écran noir de mes nuits blanches,
Moi je me fais du cinéma
Sans pognon et sans caméra,
Bardot peut partir en vacances… »
Il voulait laisser l’image d’un bon acteur, d’un
bon conteur. Mission accomplie monsieur Gregory Peck !
|
|




|
|
| |
|
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |







|
|
Le
western n’a jamais été un genre mineur.
Il en fut de très grands et presque tous les metteurs
en scène américains s’y sont risqués.
On l’a souvent limité au cadre des grands espaces
de l’Ouest américain et à l’époque
des pionniers cependant l’action de films comme « Les
Tuniques écarlates » de C.B. de Mille, de
1940, ou « Vera Cruz » de Robert Aldrich,
de 1954, se passe respectivement au Canada et au Mexique. Et
si la majorité des westerns se situent entre 1860 et
1890, certains sont antérieurs à la guerre d’indépendance
comme « Le grand passage » de King Vidor,
de 1939 et d’autres y sont au cœur même, comme
« Sur la piste des Mohawks » de John Ford,
de 1939. On finirait par y perdre son latin si l’on considère
que, du Texas au Mexique, certains évoluent sur le Rio
Grande même, ou de part et d’autres. « La
rivière Rouge » de Howard Hawks, de 1948 et
« Alamo » de John Wayne, de 1960, en sont
des exemples.
Pour la petite histoire, il faut se souvenir qu’en 1900,
l’Ouest commençait à Chicago et aujourd’hui
encore, de nombreux éléments de la tradition western,
notamment vestimentaires et alimentaires, sont vivants au Texas,
en Arizona et au Colorado.
Le western est aussi ancien que le cinéma américain.
Après tout « L’attaque du grand rapide »
de Edwin S.Porter date de 1903. La plus ancienne trace d’un
enregistrement sur ce thème date de 1894 lorsque Buffalo
Bill et Annie Oakley posèrent devant le kinescope d'Edison.
William K. Everson dira de ce film : « C’est
le premier western avec une forme reconnaissable ! »
Dès 1911, Henry Hathaway, avant d’être metteur
en scène, fera des débuts d’acteur dans
des films d’une ou deux bobines. John Ford, le maître
incontesté du genre, jouera pour son frère Francis
en 1917 et Griffith interprétera un rôle dans un
court métrage « The Devil » en
1908. Le premier film dirigé par C.B. De Mille « Le
mari de l’Indienne » date de 1914. Jusqu’en
1920, les arguments sont simples et cette production avec des
bandes courtes est peu connue. Les années 20 verront
apparaître des films plus longs, la technique de la photographie
s’étant nettement améliorée.
À partir de cette époque, la majesté des
paysages, les situations épiques, « La caravane
vers l’Ouest » de James Cruze, de 1923, se
développent. Il y aura dans ce film 3000 figurants dont
1000 Indiens. Puis viendra « Le cheval de fer »
de Ford en 1924 qui est, ni plus ni moins, l’histoire
de l’Union Pacific Railroad. Dès le début
du parlant « La piste des géants »
de Raoul Walsh, de 1930, raconte l’ouverture de la piste
de l’Oregon. Pour l’anecdote, ce film sera tourné
en 70 mm, par une équipe de 14 opérateurs, avec
un John Wayne totalement inconnu du public et n’aura aucun
succès. Le western de l’époque ne rassemblait
guère de spectateurs dans les salles. Des films comme
« Billy the Kid » de King Vidor, de 1930,
ainsi que « The Squaw Man » de C.B. De
Mille, de 1931, méritent pourtant encore d’être
vus. Déjà, les séries B marchaient plutôt
bien avec des héros comme Gene Autry ou Roy Rogers dans
des rôles de cow-boys chantants. John Wayne s’y
plia sans plus de conviction. D’autres westerns musicaux
(Horse opéras) seront interprétés par des
noirs comme dans « Harlem on the prairie »
de Sam Newfield de 1938. Dans l’intervalle, le western
de qualité renaîtra avec « La légion
des damnés » de Vidor, en 1936, et à
partir de 1939, les thèmes traités se multiplieront
comme dans « Pacific express » de De Mille
et en 1941 et dans « La charge fantastique »
de Walsh.
Le passage à la couleur vers les années 40 donnera
du corps aux westerns. La montée des périls en
Europe ne sera pas étrangère à certains
thèmes moralisateurs comme en 1946 « La poursuite
infernale » avec Henry Fonda dans le rôle de
Wyatt Earp. Dès 1948, la cavalerie américaine
reviendra souvent comme un message d’ordre et de sécurité :
« Le massacre de fort Apache » en 1948,
« La charge héroïque » en
1949, « Rio grande » en 1950. C’est
à cette époque que se formeront des communautés
d’équipe autour de John Ford avec son ami John
Wayne et d’autres comme Ward Bond, Jack Pennick et Ben
Johnson. C’est à cette époque, en 1948,
que Ford réalise « Le fils du désert »
et avec l’introduction du technicolor, ses archétypes
de personnages s’en trouvent renforcés. Pour la
petite histoire, il ne fit jamais l’unanimité ;
les plus modérés le trouvaient de parti pris et
les autres… fasciste, contrairement à Vidor qui
fit aussi des chefs d’œuvres comme « Duel
au soleil » en 1947. Henry King et King Vidor introduisirent
dans le western la dimension lyrique et dramatique. On peut
y ajouter Hathaway avec « L’attaque de la malle-poste »
en 1951. Des personnages plus près de la réalité
apparaissent : des déracinés, des errants,
des individualistes, des radicaux voire des anarchistes ! Comme
chez Hawks. Le mauvais sauvage sera considéré
sous un nouvel angle avec sa culture et sa dignité propre.
Viendront aussi des candidats à la psychanalyse comme
dans « La vallée de la peur » de
Walsh, en 1947. Le western est influencé par le film
noir.
Le meilleur est pour maintenant : « La porte
du diable » d’Anthony Mann de 1950, « La
flèche brisée » de Daves, et ces deux
merveilles de 1970 : « Little Big Man »
d’Arthur Penn et « Soldat bleu »
de Ralph Nelson. Mais le western pro-indiens a toujours existé
: « Hondo, l’homme du désert »
de John Farrow en 1953, « Bronco Apache »
d’Aldrich en 1954, « Taza fils de Cochise »
de Douglas Sirk, « Les rôdeurs de la plaine »
de Siegel en 1960 et « Willy Boy » d’Abraham
Polonsky en 1969. Le bon blanc et le mauvais indien, devenus
caricaturaux, on verra même des idylles entre les deux
ethnies dans « La captive aux yeux clairs »
de Howard Hawks en 1952 ou « La rivière de
nos amours » d’André de Toth en 1955.
L’interrogation explicite du racisme dans le western est
un phénomène qui date de la fin des années
40.
Mais le western pouvait être aussi un prétexte
pour expliquer la dramaturgie de certaines scènes comme
dans « Le train sifflera trois fois »
de Zinnemann de 1952 ou « L’homme des vallées
perdues » de Gorge Stevens de 1953 ou également
« La dernière chasse » de Richard
Brook de 1956. Pour moi, les meilleures études de personnages
sont dans « Le dernier train de Gun Hill »
de John Sturges de 1959 ou encore dans « L’homme
aux colts d’or » d’Edward Dmytryk et
si les metteurs en scènes se sont si souvent servis du
western, c’est sûrement à cause de sa popularité
qui leur apportait une bonne audience. Certains films furent
à la fois humanistes et d’une grande qualité
esthétique : « La colline des potences »
avec Gary Cooper en 1959 en fait partie ainsi que « Trois
heures dix pour Yuma » en 1957 de Delmer Daves.
De grandes actrices prêteront leur nom au western :
Joan Crawford dans « Johnny Guitar »,
Marilyn Monroe dans « La rivière sans retour »,
Marlène Dietrich dans « L’ange des maudits ».
La période de 1950 à 1965 sera d’une étonnante
richesse. Pour n’en citer que quelques-uns : « La
chevauchée des bannis » d’André
de Toth, en 1959, Samuel Fuller avec « Le jugement
des flèches » de 1957, Henry King avec « Bravados »
en 1958, Raoul Walsh avec « Les implacables »
en 1955, Henry Hathaway avec « Les quatre fils de
Katie Elder » en 1965 et « Les Cheyennes »
de John Ford en 1964. Budd Boetticher dirigera bien souvent
Randolph Scott : « 7 hommes à abattre »,
« Le courrier de l’or », « La
chevauchée de la vengeance »... Il y eut tant
de beaux westerns que je ne résiste pas à récidiver
avec une dernière série ! « La prisonnière
du désert » de 1956 et « L’homme
qui tua Liberty Valance » de 1962 de John Ford, « Nevada
Smith » de 1966 et « Cinq cartes à
abattre » de 1968 d’Henry Hathaway.
Malgré l’abondance de cette production, le cinéma
hollywoodien subira une crise dans les années 60 dont
le western n’échappera pas. Ensuite, le modernisme
s’infiltrera dans le genre. Ce sera une bicyclette dans
« Butch Cassidy et le kid » de Roy Hill
en 1969, une automobile dans « Cable Hogue »
de Peckinpah en 1970 et le western ne sera pas épargné
par les idéologies des grandes puissances et le capitalisme.
Ça transpire dans « John McCabe »
d’Altman en 1971, dans « Les moissons du ciel »
de Malick en 1978, dans « La porte du paradis »
de Cimino en 1980 ou dans « La horde sauvage »
de Sam Peckinpah en 1969. La violence et le sadisme finiront
par envahir le western.
Robert Warshow disait : « Les deux créations
les plus réussies du cinéma américain sont
le gangster et l’homme de l’Ouest ! »
et John Ford : « Quand la légende devient
réalité, il faut imprimer la légende ! »
Une chose est sûre, le western restera une source de symboles
et de mythes, il est indissociable de la naissance d’une
nation : l’Amérique !
|
|







|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |

|
|
Dans les seconds rôles masculins français des années
30, je commencerais par le plus truculent : Aimos, pseudonyme
de Raymond Caudrilliers, est né à La Fere en 1889.
Le meilleur qualificatif que l’on peut lui donner : dégingandé,
une allure à la André Pousse, l’œil
malin, la gouaille, un titi parisien. Ce fut l’un des
plus populaires seconds rôles de l’âge d’or
du cinéma français. Le parlant lui apporte ses
premiers rôles. Sa célébrité tint
à sa verve et son naturel pour des personnages de copains
à la vie, à la mort. On le verra dans «
Quai des Brumes » de Carné en 1938, « La
Bandera » de Duvivier en 1935 et il sera d’ailleurs
un peu le second rôle attitré de Duvivier. On le
reverra dans « Le Golem » en 1935, « La Belle
Équipe » et « L’homme du jour »
en 1936. Il était très aimé du public.
Il mourra sur les barricades à la libération de
Paris le 22 août 1944. |
|

|
|
| |
 |
|
Autre
second rôle, Alcover est presque un personnage de BD avec
son long nez, ses cheveux gominés plaqués sur
le crâne et son regard vif de rapace. Il est né
à Châtellerault en 1893. Il débute à
l’Odéon après un premier prix de conservatoire,
puis à la Comédie-Française, avant de se
consacrer au cinéma. Une présence puissante dans
des films d’avant-garde, « Champi-Tortu »
de Jacques de Baroncelli en 1921 et « Feu Mathias Pascal »
de Marcel l’Herbier en 1925 l’avait fait connaître
du temps du muet. Il eut cependant un grand premier rôle
(l'affiche originale mentionne uniquement son nom sur l'affiche
avec celui du réalisateur) dans « l'Argent »
de Marcel l'Herbier en 1928 et d'autres rôles importants
dans des films quasiment invisibles de nos jours. Au début
du parlant, on ne le retrouve que dans des rôles de comparse
pour des vaudevilles, des policiers, et pire... des drames patriotiques.
Il ne faut que se souvenir de deux apparitions remarquables
dans « Un carnet de bal » de Duvivier en 1937 et
« Drôle de Drame » de Carné en 1937.
Il mourut en 1957. |
|
 |
|
| |
 |
|
André
Jaubert, né en 1907, pseudonyme Andrex n’aurait
pas pu exister au cinéma sans l’amitié de
Fernandel grâce à qui il fit une carrière
honnête. Après avoir été chanteur
à l’Alcazar de Marseille puis au Concert Mayol
à Paris, il obtiendra son premier rôle au cinéma
dans « Angèle » de Pagnol en 1934 puis dans
« Un carnet de bal » de Duvivier en 1937. Ce sera
ensuite « Hôtel du Nord » de Carné
en 1938 et « Fric-frac » de Lehman en 1939. Sa bonne
tête lui fera endosser le masque de personnages méridionaux
dans « Honoré de Marseille » de Maurice Regamey
en 1956 et dans « Sous le soleil de Provence » de
Soldati en 1956... il s’éteindra à Paris
en 1989. |
|
 |
|
| |
 |
|
Quant
à Charpin, né en 1887, il sera très vite
connu grâce à Pagnol. Charpin, c’est Pagnol
et Pagnol, c’est Charpin ! Grâce à son sens
inné de la réplique, il jouera dans « César
» en 1936, dans « La Femme du Boulanger »
en 1938 et dans « La Fille du Puisatier » en 1940.
Lorsque l’on prononce le nom de Charpin, on entend déjà
chanter les cigales. Mais il ne sera pas limité aux rôles
méridionaux comme en attestent « Pépé
le Moko » et « La belle équipe » de
Duvivier en 1936. Grande verve, grande assurance, Charpin avait
tout pour faire un premier rôle. Il était, j’ai
le regret de le dire pour ses détracteurs, aussi bon
que Raimu. Charpin est mort en 1944.
|
|
 |
|
| |
 |
|
Celui
qui aurait pu jouer du Molière, c’est Saturnin
Fabre tant sa diction était incroyable. Né en
1883, on pourrait dire de cet homme qu’il était
habillé d’une folie grandiose ; il donnait à
ses rôles un relief extraordinaire, un caractère
d’ambiguïté, tour à tour comique ou
inquiétant. Il en eut de très beaux dans «
Pépé le Moko » de Duvivier et dans «
Messieurs les ronds de cuir » d’Yves Mirande en
1936, puis dans « Désiré » de Sacha
Guitry en 1937. Également dans « La Nuit Fantastique
» de Marcel L’Herbier en 1942, « Marie-Martine
» d’Albert Valentin en 1943, « Les Portes
de la Nuit » de Carné en 1946 et « La Fête
à Henriette » de Duvivier en 1952. Il mourut en
1961. |
|
 |
|
| |
 |
|
Sûrement
moins connu, Alerme, né à Dieppe en 1877 était
l’homme tout en rondeur du cinéma français.
Tous les chemins semblent mener à Rome car ce sera après
avoir renoncé à la médecine et à
la sculpture qu’il débuta à l’écran
dans les années 20. Il fut aussi un acteur de scènes
de boulevard. Il faut résumer sa carrière car
il ne fit pas moins de 70 films. Les plus connus restent «
La kermesse héroïque » de Feyder en 1935,
« L’homme du jour » de Duvivier en 1936, «
Paradis perdu » d’Abel Gance en 1940, « Le
jour se lève » de Carné en 1939. Il mourut
en 1960. |
|
 |
|
| |
 |
|
Gabriel Gabrio, un personnage oublié de tous qui fit
une remarquable apparition dans « Les Misérables,
l’évasion de Jean Valjean » d’Henri
Fescourt en 1925. Il est né à Reims en 1888 et
sera une grande vedette des années 20. Il s’adaptera
très vite au parlant dès 1935 et fera une remarquable
apparition dans « Regain » de Pagnol en 1932 et
dans « Pépé le Moko » de Duvivier
en 1936. Puis, d’un seul coup, il sera condamné
aux seconds rôles. Le destin lui avait définitivement
joué un mauvais tour. Il mourut en 1946.
|
|
 |
|
| |
 |
|
Celui dont le regard pétillant ne trompe personne, Marcel
Peres (pseudonyme de Marcel Farenc) est né à Castelsarrasin
en 1898 et fait rare, il débute sur les planches dans
des spectacles forains de son beau-père. En 1924, il
montera à Paris pour y faire de la figuration dans des
films muets. On le connaîtra grâce à ses
parrains de cinéma : Jean Gabin et Roger Blin. Le premier
le fera engager dans « Variétés »
de Nicolas Farkas en 1935 et le second dans « Mollenard
» de Robert Siodmak en 1938. Il deviendra le personnage
le plus bourru du cinéma français. Il n’arrêtera
plus de tourner : « La Charette fantôme »
de Duvivier en 1939, « Goupi mains-rouges » de Becker
en 1943, « Les enfants du paradis » de Carné
en 1944 et « Un drôle de paroissien » de Mocky
en 1963.Pour l’anecdote, son dernier film « Le fantôme
de la liberté » de Buñuel sortira un mois
après sa mort le 28 juin 1974.
|
|
 |
|
| |
 |
|
On
peut également citer un ami de Picasso et de Modigliani,
Gaston Modot, né à Paris en 1887 ; il fut lui-même
peintre avant de passer au 7e art en 1910. Il fit une carrière
prestigieuse, cinquante années de travail pour le cinéma.
Il incarnera avec la même désinvolture les traîtres,
les figures patibulaires, les comiques et les héros de
drames. Il sera admirable dans « L’Opéra
de Quat’sous » de Georg Wilhelm Pabst en 1931, «
La grande illusion » et « La règle du jeu
» de Renoir en 1937 et 1939, « Les Enfants du Paradis
» de Carné en 1944, « Rendez-vous de juillet
» de Becker en 1949 et dans les trois films phares de
sa carrière : « La Bandera » en 1935, «
Pépé le Moko » en 1936, « La fin du
jour » en 1939. En plus de la peinture et du métier
d’acteur, il écrira aussi des scénarios.
Il mourut en 1970. |
|
 |
|
| |
 |
|
Évidemment,
on ne peut pas oublier Pierre Renoir, le fils aîné
du peintre. Il est né à Paris en 1885 et débutera
au théâtre avec Valentine Tessier qui fut sa compagne
dans la vie pendant quelques années. Il jouera beaucoup
dans les années 30, toujours dans la troupe de Louis
Jouvet, il deviendra même une véritable tête
d’affiche dans des emplois comparables à ceux de
Raimu ou Harry Baur. Ses meilleurs films restent « La
Bandera » de Julien Duvivier en 1935, « La Marseillaise
» en 1938 de son frère Jean Renoir, « La
Maison du Maltais » de Pierre Chenal en 1938, «
Dernier Atout » de Becker en 1942, « Le Loup des
Malveneur » de Radot et « Les Enfants du Paradis
» de Carné en 1944. Il mourut en 1952. |
|
 |
|
| |
 |
|
J’ai
gardé pour la fin le destin étrange d’un
homme aux yeux de condor des Andes qui est mort à Buenos-Aires
en 1972 : Robert le Vigan (pseudonyme de Robert Coquillaud)
né à Paris en 1900. Il sortira du conservatoire
en 1918, fera un début de prestigieuse carrière
au théâtre puis se sera le cinéma avec «
Les cinq gentlemen maudits » de Duvivier en 1931 qui fera
de nouveau appel à lui en 1933 pour être le fou
dans « Le petit roi ». Jean Renoir lui confiera
le rôle du marchand d’étoffe dans «
Madame Bovary » en 1934 et il portera comme des stigmates
une prodigieuse silhouette de prophète halluciné
en incarnant le Christ dans « Golgotha » de Duvivier
en 1935. Toujours avec le même « La Bandera »
en 1935 puis suivront « Regain » de Pagnol en 1937,
« Quai des Brumes » de Carné en 1938, «
Goupi mains-rouges » de Becker en 1943. Viendra ensuite
la période trouble qui précipitera sa vie et sa
carrière dans le néant : 1944, il fuit à
Sigmaringer avec son ami Louis-Ferdinand Céline qui l’avait
entraîné dans la collaboration. Arrêté,
il sera condamné à 10 ans de réclusion
de travaux forcés et à l’indignité
nationale à vie. Mis en liberté conditionnelle,
il gagnera l’Espagne puis l’Argentine où
il tournera encore quelques petits films insignifiants. Malraux
aurait pu dire : « la guerre est un effrayant révélateur
de la condition humaine » (dixit la voix royale)... |
|
 |
|
| |
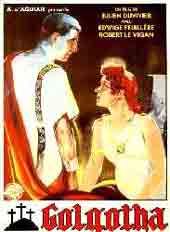
|
|
 |
 |
 |
|

|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Suzanne
Flon 1918-2005 |
|
|
|
| |



|
|
On
nous assomme avec les superstars, des vedettes qui descendent
l’escalier, à Cannes, avec des tonnes de tissu
accrochés aux hanches, mais s’il en est une qui
m’a toujours fait grande impression par sa douceur,
sa pudeur, sa voix aux intonations basses mais toujours audible,
son charme décalé dans une époque où
certaines en font trop, les plongeant dans la caricature façon
Daumier, c’est Suzanne Flon !
Elle est née au Kremlin-Bicêtre en 1923. Après
une représentation d’Andromaque, elle déclare
à ses parents qu’elle sera comédienne
mais il n’en est pas question, le métier présente
bien trop de compromissions. Qu’à cela ne tienne,
elle fait des études d’anglais en attendant son
heure. Elle trouve un emploi d’interprète au
Printemps, rencontre Edith Piaf et devient sa secrétaire.
Une façon comme une autre d’aborder le monde
du spectacle. En 1947, Raymond Rouleau la remarque. Elle débute
au théâtre sous le pseudonyme d’Anne Lancel.
Elle se fait connaître dans « Le Mal court »
d’Audiberti et elle ne quittera plus le métier
de la scène qui l’accaparera, ne lui laissant
que peu de temps pour le cinéma, avec un regret toutefois,
celui de n’avoir jamais joué Racine et Marivaux.
Elle a pourtant abordé les plus grands, de Goldoni
à Pirandello en passant par Musset, Tchekhov et bien
d’autres.
Elle débute cependant au cinéma dans «
Capitaine Blomet » d’Andrée Feix en 1947.
Ensuite, Huston l’engagera pour « Moulin Rouge
» en 1953 et, tenez-vous bien, Orson Welles pour «
Monsieur Arkadin » en 1955. Lorsque l’on songe
à l’intransigeance d’un Welles, on sait
qu’elle fera son chemin. En 1960, Claude Autant-Lara
lui donne l’un de ses plus beaux rôles, la mère
d’un objecteur de conscience dans « Tu ne tueras
point ». Un rôle d’une puissance incontestable.
Puis ce sera, pour n’en citer que quelques uns : en
1962 « Un singe en hiver » de Henri Verneuil,
et « Le Procès » d’Orson Welles,
puis en 1964 « Le Train » de John Frankenheimer,
en 1967 « Tante Zita » de Robert Enrico et «
Le Franciscain de Bourges » de Claude Autant-Lara, en
1969 « Jeff » de Jean Hermann et « Sous
le signe du taureau » de Gilles Grangier. La liste est
considérable, presque toujours dans des seconds rôles,
ce qui fait que le public ne la portera jamais aux nues. Malgré
tout, elle tournera avec beaucoup de régularité
pour de grands cinéastes. En 1971, « Térésa
» de Gérard Vergez puis « Monsieur Klein
» de Joseph Losey en 1976. Mais sa vérité,
c’est le théâtre !
Au cours des années 80, on la revoit avec beaucoup
de plaisir interpréter des rôles modestes mais
remarqués. Dans « L’été Meurtrier
» de Jean Becker en 1983 puis « En toute Innocence
» de Alain Jessua en 1988. Un autre superbe film «
La Vouivre » de George Wilson en 1989 et « Gaspard
et Robinson » de Tony Gatlif en 1990.
Ses derniers films seront : en 2002, « La fleur du mal
» de Chabrol et « Effroyables jardins »
de Jean Becker, en 2003 « La demoiselle d’honneur
» de Chabrol, en 2004 « Joyeux Noël »
de Christian Carion et en 2005 « Fauteuils d’orchestre
» de Danièle Thompson. Elle n’a jamais
cessé de tourner.
Suzanne Flon promène un souffle de vie au-dessus de
nos têtes, une douce brise marine qui ne peut venir
que de l’océan ; elle est une des fées
de Neptune dans un monde qui s’attarde trop souvent
sur le superficiel. À force de ne plus savoir regarder,
sentir, toucher, on devient infirme du cœur sans s’en
rendre compte. Celui de Suzanne Flon était très
beau. Il avait un goût de miel et d’eau saline.
Je suis très heureux de m’être offert,
en ce jour, le luxe de ne pas l’avoir oubliée.
|
|



|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
suite…
|
|
|
|
|